|
exclusif : le DD a 20 ans … exclusif : le DD a 20 ans …
20 ans d’évolution du développement durable
Le «développement durable», tout le monde en parle, depuis plus de 20 ans.
Dans un esprit citoyen, education.france5.fr s'engage et propose une centaine de vidéos sur des thèmes liés à l'environnement : climat, énergie, ressources naturelles, déchets, biodiversité.
En 2007, le moment est venu de résoudre les problèmes et chacun, dans son domaine, peut agir.
TRANSFORMER DE L'EAU SALÉE EN EAU DOUCE
L'eau douce devenant une denrée rare, certains pays commencent à dessaler l'eau de mer. Reproduire ce phénomène, c'est ...
Voir
la Vidéo... Cliquez ici |
 |
 |
Les
Nouvelles 24/07/2007
Les
perspectives d'énergies renouvelables à Madagascar
A
cause de la flambée des prix du pétrole sur les marchés
internationaux et l'épuisement de l'énergie fossile à terme,
tous les pays se tournent vers les énergies renouvelables.
Madagascar
n'est pas en reste dans cette nouvelle optique quoique, pour le
moment, le bois de chauffe et le charbon de bois (qui figurent
parmi les énergies renouvelables) fournissent encore 80 % de l'énergie
consommée au pays. Mais avec leur mode d'utilisation actuelle,
ils ne seront pas durables et en fin de compte non renouvelables.
Quid des autres énergies renouvelables qui intéressent le pays ?
Par la disponibilité
et la répartition de surfaces pour la plantation de bois,
jatropha et canne à sucre, le potentiel éolien au Nord et au
Sud, Madagascar est à mesure d'assurer une autonomie énergétique
durable.
Le biodiesel et le bioéthanol
sont les carburants de substitution les plus répandus sur le
marché mondial. Non seulement, ce sont les biocarburants les plus
prometteurs à court terme, mais de plus, de par leur nature
renouvelable, ils constituent également la solution de choix pour
réduire les émissions de CO2 et un moyen de réduire la dépendance
vis-à-vis des importations de pétrole et de diversifier
l'agriculture en offrant de nouveaux débouchés.
Malgré des avantages désormais
reconnus et une technologie toujours plus éprouvée,les
biocarburants liquides doivent, aujourd'hui encore, faire face à
de nombreuses barrières qui sont autant de freins à leur développement
et ne représentent pas plus de 1 % de la consommation de
carburants conventionnels à l'échelle mondiale.
Le
biodiésel
Le biodiésel peut être
produit à partir de toute huile végétale : huile de colza,
tournesol, arachide, soja, palme, jatropha… Mais c'est cette
dernière qui est la plus prisée car c'est une plante bien connue
à Madagascar, capable de se développer sur les terrains
marginaux et dans les régions arides.
De plus, c'est une
culture facile car c'est une plante non exigeante. Son plus grand
avantage est que c'est une plante qui n'entre pas en concurrence
avec les cultures vivrières et elle peut être utilisée comme
essence de reboisement (en re-végétation des tanety). Le biodiésel
peut être aussi utilisé pur ou en mélange.
Comme le biocarburant,
le biodiésel présente aussi des avantages et des contraintes.
Avantages du
biodiésel :
- réduction des émissions
de gaz et de particules (monoxyde de carbone : inférieur ou égal
à 50 %).
- meilleure
lubrification
- stockage plus sécurisant
- combustion plus complète
des chaînes hydrocarbonées
- diminution des
importations de pétrole (donc économie de devises)
- possible valorisation
des sous-produits (tourteaux)
Contraintes du
biodiésel :
- législation non définie
(en cours) quant à l'utilisation du biodiésel
- besoins
d'investissements importants
- compétitivité
incertaine sur le marché.
Opérateurs
principaux :
- D1 Oils Madagascar
(2005)
- Green Energy
Madagascar (2006)
- Madagascar Minerals
Fields (2006)
L'arrivée d'autres opérateurs
intéressés par la production de biodiésel est déjà prévue
cette année.
Production basée sur
les plantations actuelles avec 2 raffineries :
- 10.000 ha de jatropha
atteignant le rendement de croisière
- 50.000 T de graines
- 15.000 T d'huile
brute
- 35.000 T de tourteau
pour l'engrais et le biocombustible
- 15.000 T de biodiésel
Perspectives
2010 :
Surface plantée :
100.000 ha
Production : 150.000 T
de biodiésel en rendement de croisière
Besoins en gasoil
(2005) : 362.000 tonnes
L'éthanol
Madagascar possède des
usines de production d'éthanol. Elles ont produit jusqu'ici de
l'alcool de bouche et de l'alcool à usage industriel (pharmacie,
laboratoire…). Ces sociétés connaissent des difficultés et
travaillent au plus bas de leur rythme.
Par contre, la
production artisanale d'éthanol a connu une forte augmentation,
mais celle-ci est réprimée par la loi.
Investisseurs
dans la filière éthanol :
- Jason World Energy :
90.000l/j en phase d'implantation, travaillant à partir de mélasse
importée en attendant la production locale.
- GEAR : en phase d'étude
- Complant : reprise
des activités de la Sirama.
Comme pour tout
produit, l'utilisation de l'éthanol présente des avantages et
des contraintes. Dans le cas de la production à partir de la
canne à sucre, parmi les contraintes, on peut citer : une législation
non définie (en cours) quant à l'utilisation de l'alcool comme
biocarburant, les besoins d'investissements sont importants tant
sur la culture que sur la transformation, la consommation en
carburant est 4 fois plus importante que celle de l'essence
conventionnelle, la compétitivité est plus ou moins incertaine
sur le marché (voir comparaison des coûts ci-après).
|
Le coût :
1.737
ariary/litre (Sirama
2006) soit 0,75 € / litre
Prix HTT essence et coût
de production des biocarburants € / litre
- Essence Europe brut
à 25 $/baril 0,2
- Essence Europe brut
à 60 $ /baril 0,4 / 0,45
- Ethanol Europe 0,5
- Ethanol Brésil 0,2
- Ethanol Etats-Unis
0,3
Source :
CIVEPE.
Janvier 2006-Prix et coûts des différents carburants en août
2005
Par contre, parmi ses
avantages, on peut dire que c'est une activité créatrice
d'emplois. De plus, elle peut entraîner un développement régional
rapide par l'installation des complexes industriels. La production
d'éthanol sur place diminuera les importations de produits pétroliers
(ce qui entraînera une économie de devises). Autre avantage non
négligeable : les sous-produits sont très intéressants
(bagasse).
L'éthanol peut être
utilisé pur (100 %) ou en mélange selon les spécificités des
moteurs.
Biogaz
Le biogaz est le résultat
de la dégradation, par des bactéries de matières organiques
(fumier animal, matière végétale, déchets d'entreprises,
ordures ménagères) enfermées dans une cuve.
Le type de gaz obtenu
est le "gaz méthane" composé à 75 % de méthane et à
15 % de CO2, Azote…
Compte tenu de la matière
première utilisée, la production de biogaz est surtout propice
en milieu rural.
Au niveau de la
production, 1 tonne de matières premières (déchets, fumier…)
produira 30 à 40 m3 de biogaz (soit 200 kW)) et peut aller jusqu'à
60 m3 .
Ce gaz peut être
utilisé en tant que combustible de maison (cuisson, chauffage).
Et le compost (produit restant après la formation de gaz) est un
très bon fertilisant.
Les principes de
production de biogaz sont assez simples : il faut placer les déchets
dans une cuve à l'abri de l'oxygène à une température idéale
se situant entre 32 et 37 °C (favorable au développement des
bactéries). Le gaz se dégage lorsque les déchets pourrissent.
Il faudra alors recueillir le gaz obtenu dans un récipient étanche
(simple baril).
Avantages du
biogaz :
C'est un combustible
propre ne produisant pas de fumée. Il préserve également
l'environnement (pas de dégagement de méthane dans l'atmosphère,
diminution des coupes de bois). Le coût de revient d'installation
d'une unité de production est relativement faible.
Coût
d'installation (pour une unité) :
- Matières premières
(1 tonne) Ar 30.000
- Barils Ar 60.000
- Tuyau, conduite de
gaz Ar 80.000
- Valves, matériaux
d'obturation Ar 25.000
TOTAL Ar 195.000
Inconvénients
du biogaz :
L'utilisation du biogaz
présente quand même quelques inconvénients. Tout d'abord, les
techniques de méthanisation sont souvent méconnues. De plus,
bien souvent, le biogaz est produit loin des lieux de
consommation, donc difficile à valoriser. Enfin, l'installation
est assez onéreuse pour une famille paysanne.
Énergie
éolienne
C'est un principe vieux
comme les moulins à vent. Le vent fait tourner les pales qui sont
elles-mêmes couplées à un rotor et à une génératrice..
Lorsque le vent est
suffisamment fort, les pales tournent et entraînent la génératrice
qui produit de l'électricité; à vrai dire, l'éolienne est un
dispositif permettant de transformer l'énergie du vent en électricité
. C'est le même principe que celui du dynamo de vélo.
Différentes
catégories d'éoliennes :
Il existe deux grandes
catégories d'éoliennes :
- les éoliennes à
petites échelles à usage domestique de faible puissance qui
fournissent de l'électricité aux sites isolés pour des besoins
individuels.
- Et les éoliennes de
grande puissance raccordées aux réseaux nationaux.
Différents
types d'éoliennes :
Il existe différents
types d'éoliennes :
- les éoliennes à axe
vertical et à axe horizontal. Ce dernier semble mieux convenir à
la production d'électricité.
- L'éolienne de
fabrication artisanale ou le générateur est directement couplé
aux pales pour fabriquer un courant continu et alternatif. Ces énergies
captées pourraient être stockées dans un parc de batteries ou
un autre dispositif de stockage d'énergie.
Le coût de l'éolienne
dépend de la consommation et de son utilisation (le nombre d'éclairage
utilisé…), du nombre d'heures d'utilisation et du lieu de son
implantation.
Avantages de l'énergie
éolienne :
L'énergie éolienne
est une solution au problème du réchauffement climatique car
elle peut participer à la diminution, en partie, de l'utilisation
de l'énergie fossile.
C'est une source d'énergie
inépuisable à l'échelle de l'homme.
Elle est bénéfique
sur le plan environnemental, social et économique : c'est une énergie
non polluante, qui protège la biodiversité, réduit les déchets,
prévient les catastrophes naturelles. Enfin et surtout, les
ressources de la planète ne sont pas surexploitées.
Dossier réalisé par : Ranaivo Lala Honoré
grâce
aux informations fournies par l'Association Inwent Madagascar
(association des anciens stagiaires et boursiers d'Allemagne).
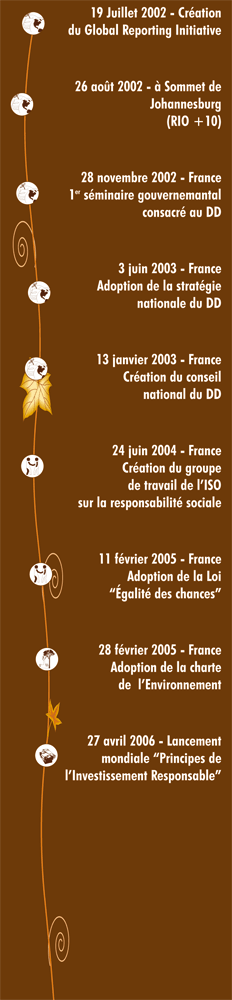 |
Libération.fr
04/08/2007
Le développement durable a 20 ans
Le 4 août 1987 était présenté à l’ONU un rapport fondateur : «Notre avenir à tous».
Le 4 août 1987, une révolution douce s’amorçait. Il y aura vingt ans jour pour jour demain, le terme de «développement durable» s’officialisait devant l’Assemblée générale des Nations unies par la présentation du rapport du Premier ministre norvégien, madame Gro Harlem Brundtland. Il est certes toujours possible de repérer l’expression dans d’autres documents antérieurs, mais chacun s’accorde à reconnaître le rapport «Notre avenir à tous», dit rapport Brundtland comme le document fondateur du développement durable. L’expression fut vraiment popularisée à partir de juin 1992 à l’occasion du sommet de la Terre à Rio de
Janeiro, lui-même conséquence dudit rapport qui en définissait les contours.
C’est donc un anniversaire majeur que nous pouvons célébrer car, si la dénomination «développement durable» reste un peu absconse pour l’opinion publique, elle fait aujourd’hui l’objet d’un large consensus auprès des parties prenantes. Car le développement durable portait en lui les germes d’une transformation profonde : il reconnaissait l’égalité et l’interdépendance des sphères sociale, environnementale et économique, ouvrait nos perspectives sur le long terme et l’intégration des générations futures, et apportait un véritable mode de gouvernance au travers de ses trois piliers, les principes du «pollueur payeur» et ceux de prévention et de précaution.
Même si le terme fait toujours l’objet de critiques et d’une surutilisation par les communicants d’entreprise, force est de reconnaître que ses impératifs furent largement intégrés dans l’entreprise, par éthique peut-être, par conviction sans doute, mais certainement aussi par intérêt bien compris d’un nouveau rapport de forces entre actionnaires, financiers, ONG, société civile et médias, chacun ayant un motif de veiller à la bonne application des principes du développement durable. Nous assistons donc à un curieux paradoxe : au moment où, enfin, le développement durable trouve sa pleine légitimité, l’équilibre dont il est intrinsèquement porteur n’a jamais été autant remis en question. En effet, un de ses apports majeurs était l’acceptation de l’égalité des trois sphères. Or on constate que non seulement la sphère sociale s’effiloche de plus en plus et se réduit au saupoudrage de quelques paramètres d’égalité homme-femme dans les échelons de direction d’entreprise, agrémentés d’un peu de diversité culturelle ; mais qu’en outre la sphère environnementale se réduit elle aussi pour se confondre de plus en plus avec la seule préoccupation de changement climatique.
Loin de nous évidemment l’idée de minimiser celle-ci, mais force est de constater que ce brise-glace médiatique de notre atermoiement, éclaireur de conscience à coup de plaies météorologiques, se retrouve malgré lui le résumé simplifié d’une idée qui posait à l’origine beaucoup plus de questions sur notre système de développement. Et voir quelques entreprises nommer des interlocuteurs «climat» dans des structures de gestion du risque ou dans des directions commerciales sans connexion avec les directions du développement durable, en vertu de reventes potentielles de quotas de carbone, loin d’une bonne nouvelle, apparaît par trop comme une aberration structurelle. Il faut donc sauver l’esprit du développement durable qui, en dépit de son caractère sans doute trop englobant, souvent porteur de confusion, représente aussi la chance de réduire les cloisonnements dans des frontières normatives trop étanches.
Le développement durable n’est pas juste un mode de production économique comme a voulu le faire croire le sommet de Paris en février 2007 baptisé «sommet de la croissance écologique» afin d’éviter le mot de développement durable. Il est une occasion unique de retrouver du sens. Et puisque nous en sommes aux célébrations, nous pourrions relier le 50e anniversaire du traité de Rome au 20e anniversaire du rapport Brundtland et au 10e anniversaire du protocole de Kyoto, tant le développement durable peut représenter pour l’Europe l’incarnation moderne de sa vision mondiale, une troisième voie multipartite, tempérante et raisonnée qui se propose comme modèle entre la foi inébranlable et aveugle dans le progrès de ses alliés américains et l’envie irréfrénable de croissance de ses clients chinois et indiens. Déjà inscrit en substance dans le traité de Maastricht (1992), explicitement affirmé dans les traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2000), la Constitution européenne faisait du développement durable le troisième objectif affiché de l’Union après la paix et la liberté, et c’est sans doute un signe fort de voir travailler de concert les diplomaties britanniques et françaises à faire du protocole de Kyoto une nouvelle donne mondiale. En cette période de relance et de commémoration, il est peut-être temps de prendre prétexte de ce consensus et d’appeler à un acte symbolique fort pour l’Europe : la nomination d’un ministre européen du Développement durable. Que le premier des ministres que pourrait désigner l’Union européenne soit celui du Développement durable, il y aurait là un sujet de cohésion pour l’Europe et une affirmation de sa détermination à affronter ensemble les grands enjeux de demain. Que les 27 puissent parler d’une seule voix lorsque la planète est en question, et notamment pour les négociations qui prépareront le prochain traité sur les gaz à effet de serre, voilà qui serait aussi un beau moyen de nous réconcilier avec l’Europe.
Thierry Libaert a notamment publié : « Environnement et Entreprises - En finir avec les discours», avec Dominique Bourg et Alain
Grandjean, préface de Nicolas Hulot, aux éditions Village Mondial, 2006.
Par Mathieu Baudin, enseignant, chercheur en prospective, et Thierry
Libaert, maître de conférences à Sciences-Po.
QUOTIDIEN : vendredi 3 août 2007
http://education.france5.fr/developpement%2Ddurable/
Le «développement durable», tout le monde en parle, depuis plus de 20 ans.
Dans un esprit citoyen, education.france5.fr s'engage et propose une centaine de vidéos sur des thèmes liés à l'environnement : climat, énergie, ressources naturelles, déchets, biodiversité.
En 2007, le moment est venu de résoudre les problèmes et chacun, dans son domaine, peut agir.
|
|