|

Fafah
deRainizafimanga.com
|
"Une
enfance malgache ... "
Paru
dans la collection
« Graveurs
de Mémoire »
I
l
n’est pas malgache, il n’est pas un « Zanatany »…Il
incarne pourtant à la fois l’un et l’autre. Vous l’avez
deviné, il est issu d’un père français et d’une mère
malgache. Point n’est
alors besoin de faire de l’anthroponymie si l’on porte
un tel nom de famille ; DUMOUX, héritage, souvenir de
ses ancêtres qui vécurent en France.
|
Mais,
combien il incarne aussi son origine malgache par son sourire, sa
gentillesse, sa discrétion. Lâchons le morceau : Il est métis. Ce terme
est profondément chargé d’histoire tant personnelle de l’
exceptionnel auteur du livre « Une enfance malgache »
que de l’Histoire de Madagascar. Christian DUMOUX est, en effet, né
à Madagascar, au milieu du siècle dernier, et a passé toute son
enfance dans la Grande Ile... (... suite plus bas)
Fafah

Fafah
de LaComm' Rainizafimanga avec Christian Dumoux, et Claudia Solofolandy
|
A
la decouverte de la culture malgache
Les
débats littéraires
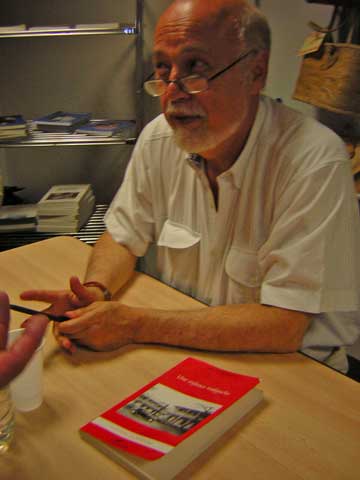
page3: Extraits
d' "Une enfance malgache"... cliquez ici
>>
page1:
Le
Reportage photo... cliquez ici
>>
La
Culture est un luxe, Partageons-la !...
"Je
vous aime comme la voatavo: Fraiche, je vous mange.
Sèche,
je fais de vous une tasse.
Cassée,
je fais de vous un chevalet de valiha:
Je
jouerai doucement au bord des routes."
|
|
|

Fafah
deRainizafimanga.com
|
"Une
enfance malgache
"
Christian
Dumoux
Paru
dans la collection
« Graveurs
de Mémoire »
Editions
L’Harmattan
|
I
l
n’est pas malgache, il n’est pas un « Zanatany »…Il
incarne pourtant à la fois l’un et l’autre. Vous l’avez
deviné, il est issu d’un père français et d’une mère
malgache. Point n’est
alors besoin de faire de l’anthroponymie si l’on
porte un tel nom de famille ; DUMOUX, héritage,
souvenir de ses ancêtres qui vécurent en France.
Mais, combien il incarne aussi son origine malgache par son sourire, sa
gentillesse, sa discrétion. Lâchons le morceau : Il est métis. Ce
terme est profondément chargé d’histoire tant personnelle de
l’ exceptionnel auteur du livre « Une enfance malgache » que de
l’Histoire de Madagascar. Christian DUMOUX est, en effet, né
à Madagascar, au milieu du siècle dernier, et a passé toute
son enfance dans la Grande Ile.
I
l
a ensuite vécu dans plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne pendant 25 ans, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Cameroun, au Tchad. Il travaille actuellement à Paris dans l’économie
sociale.
|
Avec
un pareil profil, incontestablement Christian DUMOUX rejoint
le cercle des littéraires dits francophones. Mais, nous nous
permettons de qualifier l’auteur, Christian DUMOUX
d’exceptionnel, car nous avons découvert avec quelle
authenticité il nous révèle qu’il est encore à la
recherche de son identité. Cela, suite à la question que lui a
posée Michèle RAKOTOSON (Ecrivain, dramaturge et journaliste
sur RFI) au cours de la rencontre-débat
littéraire, organisée
par Les Amis des Echos du Capricorne
et
co-animée
par Claudie BENOIT (Animatrice sur l’émission Echos du
Capricorne – Radio associative FPP) le
jeudi 6 juillet 2006.
|

Michèle
Rakotoson |
Une telle révélation
de l’auteur mérite, à notre humble avis, d’être soulignée
eu égard à son vécu dans un microcosme franco-malgache, dans
son enfance et son adolescence tel qu’il le narre dans son
livre. Certes, toute littérature écrite en langue française
est une littérature francophone. Force est pourtant de reconnaître
que le terme littérature francophone est bien souvent utilisé,
à tort, pour ne désigner que les œuvres d’écrivains
francophones non français (Qu’ils soient ou non européens :
Belges, Suisses, Québécois, Africains de l’Ouest, Maghrébins,
Antillais, Haïtiens, etc…). Y aurait-il donc un malentendu
dissimulant seulement une certaine rivalité entre d’un côté,
une littérature « mère » (Celle de la France, que
Réjean DUCHARME aimait nommer « l’amer-patrie »)
et de l’autre, les petites littératures qui, par rapport à
la grande, cherchent à proclamer leur autonomie et leurs
particularités ?
La
quête de l’auteur quant à son identité ; pour ne pas
sortir des lieux communs, peut-être englobe-telle consciemment
ou non tout un ensemble d’interrogations autour de la notion
d’appartenance culturelle, tout simplement ? Pour ce qui
concerne son enfance, tout est dit à la lecture de son livre,
et, confirmé par les réponses apportées lors de la rencontre
littéraire. L’influence de la culture malgache, celle de la
famille de sa mère, est forte. L’ironie du sort ? Le père
« petit blanc » est venu pour « faire fortune ».
En effet, c’est l’époque de la colonisation française
qui se fit sur le principe de l’assimilation et où la
fixation des conditions d’application du Code de l’indigénat
fait vivre la majorité de la population malgache dans l’extrême
précarité. Par contre, une minorité de colons vivent dans
l’opulence.
L’
auteur,
avec des détails poignants, nous fait partager sa vie de pérégrinations
de maisons en maisons (14, plus exactement et faisant l’objet
de 14 chapitres), de Tananarive à Diégo - Suarez. C’est un récit
où l’on rentre d’emblée dans la vie de l’auteur, presque
à la manière d’un journal de bord. D’où son originalité.
Quid de
sa quête ….dirions-nous en tant qu’ écrivain, pour n’en
rester qu’à cela ? Compte tenu des éléments recueillis
spontanément, à l’occasion de cette rencontre littéraire,
nous serions tentés de croire que l’auteur se rallierait au
concept forgé et anciennement
admis par le grand écrivain Aimé CESAIRE, celui de la négritude.
La négritude,
un courant littéraire
rassemblant des écrivains noirs francophones. A travers ce
courant, Aimé CESAIRE revendique l’identité noire et sa
culture. Ce mot, pour lui, « désigne en premier lieu le
rejet de l’assimilation culturelle ; le rejet d’une
certaine image du noir paisible, incapable de construire une
civilisation. Le culturel prime sur le politique ».
Rappelons que
la naissance de ce concept (1935) et celle d ‘une revue en
1947,« Présence Africaine », a généré
simultanément de réactions violentes tant à Dakar qu’à
Paris. Elle rassemble des Noirs de tous les horizons du monde,
ainsi que des intellectuels français, à savoir André GIDE,
Jean Paul SARTRE. Ce dernier définit la négritude comme :
« la négation de la négation de l’homme noir ».
Léopold Sédar SENGHOR, quant à lui, il l’approfondit en
opposant « la raison hellène » à « l’émotion
noire ». C’est, dit-il, « l’ensemble des valeurs
culturelles de l’Afrique noire ». Quoi qu’il en soit,
CESAIRE lui-même a dû s’ écarter du concept, le jugeant
presque raciste, ce face aux critiques émanant des écrivains
noirs ou créoles : « Le tigre ne proclame pas sa
tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore » (Wole
SOYINKA).
Grâce
à ses racines culturelles malgaches, l’auteur du livre
« Une enfance malgache » ne peut qu’appartenir à
la francophonie, avec un petit f désignant « l’ensemble des peuples ou des groupes
de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la
langue française dans leur vie quotidienne ou leurs
communications ». Notons au passage que ce fut Onésime
RECLUS (1887), géographe français de son état, qui fut le
premier à employer le mot Francophonie (Avec un grand F,
désigne « normalement l’ensemble des gouvernements,
des pays ou des instances officielles qui ont en commun
l’usage du Français dans leurs travaux ou leurs échanges) dont il était
le créateur. Mais ce n’est que plus tard, au début des années
60, avec leur projet de constituer une Communauté francophone,
par un certains nombre de Chefs d’Etat africains, que ce terme
de Francophonie sera employé de façon régulière.
Cependant, eu égard au ou à cause du constat tel que nous
avions avancé jusqu’ici, nous estimons que l’auteur
suscitera, davantage la question qui se pose de savoir ce que
l’on appelle actuellement : « NOUVELLES ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? » (Thème
d’un colloque international entre le 4 et 7 mai 1998 qui
s’est tenu à Dakar réunissant des participants venus de
trois continents et de quinze pays différents. Sous la
direction de Jean-Cléo GODIN ;Ouvrage collectif Ed. Les Presses de l’Université
de Montréal ; 2001).
I
l
s’agit ici de l’évolution parallèle et comparable de la littérature
regroupant les œuvres d’écrivains francophones non français
« en émergence, nouvelles par définition. Nouvelles,
mais possédant déjà une histoire, avec des étapes
reconnaissables, des courants successifs ; voire une préhistoire,
si l’on tient compte des importantes traditions orales. ».
Il est question en fait des littératures
africaines et québécoises. « Ces deux littératures
qui, ayant l’une et l’autre amorcé vers 1960 une entreprise
fondatrice, forcément identitaire, ont affirmé depuis 1980 de
nouvelles voix, exploré de nouvelles voies ». C’est
Amadou LY, dans un séminaire tenu à Montréal qui a lancé
cette idée de « nouveau baroque » pour tenter de définir
ce phénomène caractérisant, chacune à sa manière, (..) les
deux littératures. Aussitôt lancé, le concept s’est imposé »,
notamment auprès des chercheurs belges francophones (Liège).
|
La rencontre
littéraire autour du livre de Christian DUMOUX ainsi que la
lecture même dudit livre ont provoqué chez nous la même réflexion
que celle générée par le titre du colloque sur les « « NOUVELLES
ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? » :
La notion de baroque appliquée à la littérature
contemporaine. C’est vrai. C’est bizarre, pour nous par
exemple, et entre autres constatations d’aborder la lecture du
livre « Une enfance malgache » sans aucun préalable,
sans prologue. Car l’on qualifie de baroque tout ce que l’on
juge bizarre, fantaisiste, déplacé voire déplaisant.
|
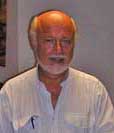
Christian
Dumoux |
Un tel sens péjoratif
du mot est hérité de la perle irrégulière des Portugais, barrocco, demeure encore dans le parler populaire. Il a traversé
tout le XVIIIè siècle et une grande partie du XIXè. Les
dictionnaires offrent de nombreuses occurrences où baroque est
associé à bizarre, à ce qui ne correspond pas à la norme,
n’est pas régulier. – Pour ce qui a trait au jugement esthétique, cette
connotation négative du mot a pris corps dans la comparaison et
l’opposition avec le classicisme. (…). En résumé, on
retiendra cinq éléments caractéristiques des deux styles :
1.Le classique est linéaire et plastique, la figure
est arrêtée dans ses contours.
Le baroque est pictural, l’image est mouvante
2.
La vision classique projette le spectacle en
surface.
La vision baroque pénètre l’espace en
profondeur.
3.La composition classique est close.
La composition baroque est ouverte.
4.Le classique procède par analyse.
Le baroque part de la synthèse, seul importe l’effet
global.
5.Le classique exige l’absolue
clarté.
Le
baroque préserve une obscurité
relative »
(Claudette
SARLET, Nouveau baroque : baroque universel ?).
A
la différence du baroque « grave » s’analysant
dans ses manifestations comme éclatants et complexes aux XVIIIè
siècle, le nouveau
baroque semble étroitement lié à l’esthétique postmoderne
(Pierre N’ DA). Pour Anna MOSSETTO, l’insolite et
l’incongru sont particulièrement visibles dans les littératures
africaines et antillaises, l’hétérogénéité et le métissage
observés dans toutes les littératures francophones. La
« perle irrégulière » d’où le baroque tient son
appellation, on la retrouve donc partout, et ce sans que l’on
sache par rapport à quelle norme, à quel barème universel, se
définirait son irrégularité.
I
l reste que
cette irrégularité permet de définir de manière non moins
intéressante l’identité même que reflète chacune de ces
littératures nationales. Cela a permis à Ursula MATHIS de
qualifier de baroque l’accumulation ou la profusion qu’elle
observe dans la littérature québécoise.
|
Quant à Michèle RATOVONONY, elle décrit l’identité
rhizomatique ou gigogne des Malgaches comme « fantaisiste,
déroutante, baroque ». En effet, « malgré le désir
d’ériger la culture et la civilisation de leur pays en pierre
angulaire de leur littérature, les écrivains malgaches
d’expression française demeurent néanmoins ouverts sur le
monde extérieur, incapables de se fermer au modèle culturel
occidental et convaincus de l’avantage que cela pourrait
apporter à leur culture originellement métisse. La conscience
de la relation avec tout ce que cela comporte d’enrichissement
constitue d’ailleurs pour eux une réalité quotidienne et
leur fait comprendre l’Autre. Le Malgache n’est-il pas, en
effet, cet être épris de fihavanana ? Valeur suprême, le fihavanana est, dans la culture malgache, un terme qui désigne, entre
autres choses, les bonnes relations et la réconciliation, avec
pour corollaire la compréhension mutuelle » (Michèle
RATOVONONY, Au seuil de la terre promise – (Roman,
notes, souvenirs) de M. F. ROBINARY (1965) : écriture de
la transgression ; Université de Montréal; in ouvrage
collectif précité).
|

Michèle
Ratovonnony
fam.Rajaofera
s/b Raferamalala |
Si déroutantes, en fait, ces « identités baroques »,
qu’elles frôlent souvent l’abîme et risquent l’éclatement,
ce que pourrait admirablement symboliser le « miroir brisé »
d’Anne –Marie NIANE. Chez cette écrivaine africaine, nous
explique Nicole AAS –ROUXPARIS, je est à ce
point un autre que « la narratrice se
noie dans sa propre altérité »….Bref, pour Christian
DUMOUX, par contre, il a du mal à s’exprimer à la première
personne dans son livre. Son enfance, il la retrace en employant
la troisième personne, Il
.
Lors de ce colloque, la littérature d’Afrique noire a
permis de vérifier l’hypothèse des « nouvelles écritures »
et aussi du « nouveau
baroque ». Il en a été ainsi car « cette littérature
peut être dite naturellement baroque, cela
tient en bonne part à l’irruption du surnaturel dans la vie
quotidienne » (Théda MIDIOHOUAN –GBISKPI) et à ce que
les auteurs de la jeune génération se nourrissent de plus en
plus aux récits – souvent fantastiques – des plus anciennes
traditions. » (Jean-Cléo GODIN, Professeur émérite de
l’Université de Montréal).
Christian
DUMOUX, nous pouvions dire que lui non plus, par le biais de son
livre « Une
enfance malgache »,
n’a pas failli à la règle. Le qualificatif d’exceptionnel
qui lui a été conféré au départ, s’avère juste à son
égard compte tenu de ce que l’on entend actuellement
par « NOUVELLES
ECRITURES FRANCOPHONES – Vers un nouveau baroque ? ».
Nous
tenons à remercier l’initiatrice de cette rencontre, Michèle
RAKOTOSON, les
organisatrices, Claudie
BENOIT et Claudia
SOLOFOLANDY dans LES AMIS DES ECHOS DU CAPRICORNE qui nous
ont permis
cette rencontre avec un écrivain
d’exception, et, bien entendu Dera RAKOTOZAKA de nous avoir
donné l’hospitalité à la Maison des Associations dans le 7ème
Arrondissement.
Note:Contact entre l'intervenante Michèle RATOVONONY-RATSIRAHONANA avec l'auteur Michèle RAKOTOSON sur le thème : "les figures du rêve dans
le bain des reliques de Michèle RAKOTOSON" lors du Colloque international "l'Océan Indien dans les littératures francophones" dirigé par KUMARI ISSUR & VINESH HOOKOOMSING, à l'Université de l'Ile MAURICE, 7 -11 juillet 1997 .
(In KUMARI ISSUR Dir. & VINESH HOOKOOMSING Dir. "L'Océan Indien dans les littératures franciphones"; Ed. Karthala - Presses de l'Université de Maurice, 2001 ; Collection Lettres du Sud ;pp. 223-235)
Andrée Ratovonony
(Fafah) -12 juillet 2006
|
|
![]()